*La passion entre Walter Benjamin et Asja Lacis
(1) actualité : livre de Antonia Grunenberg
L'étude est passionnante, surtout pour les chapitres sur le théâtre (allemand et soviétique) et les années d'internement d'Asja, la communiste sincère et authentique. Le personnage de Walter apparaît peu: la rencontre à Capri est peu développée, le séjour à Moscou escamoté...Le lecteur est frustré car le thème de l'amour (réciproque chez Walter et Asja) n'est pas vraiment abordé... JPB
Asja née Anna Liepina est née le 19 octobre 1891 en Lettonie, occupée en 1940 par l’armée rouge.
La famille s’installe à Riga, province balte de la Russie. Elle fait des études à Saint-Pétesbourg et lit les écrits de Meyerhold, célèbre homme de théâtre.
Asja épouse son ami Julijs en janvier 1914. En 1915, cours d’art dramatique à Moscou : Anna prend alors le pseudo d’Asja. Elle crée le théâtre pour enfants dans son logement, puis dans une salle de l’Univers, théâtre populaire communiste. (page 24)
-Elle a une fille Dagmara (Daga) avec son mari J. Lacis avant de divorcer. (1919)
Walter fait sa connaissance à Capri en 1924, où elle voyage avec un compagnon. Il l’avait déjà vue à Berlin, lors d’une première au théâtre (p.32). Capri, lieu de l’élite européenne (p.41)
-Est évoqué le mythe de la jeunesse allemande : Haubida (p.34)
-Walter rencontre Jula Cohn (évoquée aussi en p. 63) : à Capri.
Polémique entre WB et Zweig.
-Un grand développement sur le théâtre : Piscator et le th. Prolétarien (p.48) -Bernard Reich, amoureux d’Asja. -
-Walter vu par Asja – le livre en commun sur Naples (p.59) – Surnom de WB « l’ordonnateur »
-Ils se revoient à Berlin (p.62) et à Riga, en novembre 1925 (nuits ensemble p. 70)
-Le livre Sens unique et la technique constructiviste (p. 72)
-Asja croit Walter marxiste. Avec Reich, elle dénonce Boulgakov à la bureaucratie stalinienne.
-Elle est atteinte d’une méningite (p.85) et demande à Walter de venir la rejoindre à Moscou, le 4.12.1926 (voir le Journal de Moscou de WB) – relation triangulaire.
-Elle condamne Joseph Roth et Gide qui ont critiqué la Russie. (p.91)
-Elle revient à Berlin en 1928 et retrouve Walter.
-Évocation de Dora, épouse de Walter. (p. 99)
-Hanna Arendt à Moscou en 1930 (p. 105)
-Asja prend le train pour Paris (17.3.1933, p. 113)
-La dernière partie de l’étude est consacré au séjour d’Asja dans un camp de redressement : la communiste est internée par le régime « communiste »… Longue description qui montre la souffrance de la jeune femme et qui s’appuie sur ses mémoires, en particulier Profession : révolutionnaire…
-A la fin du livre, on apprend que Brecht et Walter n’ont pas de nouvelles d’Asja, mais qu’ils croient encore au régime stalinien. Puis c’est 1940 : WB est évoqué rapidement dans son exil dans le sud de la France ainsi que son suicide à la frontière espagnole (quelques erreurs et même fautes grammaticales de la traduction !)
Résumé du livre de Antonia Grunenberg
- - - - - - Histoire d'amour
Pendant six ans, la comédienne et directrice de théâtre a vécu avec le philosophe une liaison à éclipses, de Capri à Riga. Antonia Grunenberg retrace leurs parcours dans l’Europe intellectuelle du XXe siècle.
Antonia Grunenberg
Antonia Grunenberg, née le 2 mai 1944 à Dresde, est une politologue allemande.
Antonia Grunenberg a étudié la sociologie, la philosophie et la culture allemande à Tübingen, Francfort-sur-le-Main et Berlin. Elle obtient en 1975 un doctorat en philosophie à l'université libre de Berlin sous la direction de Jacob Taubes et passe en 1986 son agrégation en sciences politiques à l'université technique de Rhénanie-Westphalie à Aix-la-Chapelle.
Grunenberg est cofondatrice et directrice du prix Hannah-Arendt qui récompense chaque année une personnalité qui s'est distinguée par ses œuvres sur la politique et de l'action publique dans la tradition de la politologue germano-américaine Hannah Arendt. Elle est notamment membre du conseil de la Maison de l'Histoire de la République fédérale d'Allemagne de Bonn. Depuis 1998, elle occupe un poste de professeur en sciences politiques à l'université Carl von Ossietzky d'Oldenbourg. Elle est membre depuis 2006 de la commission scientifique de la Fondation fédérale pour le travail de mémoire sur la dictature de l'Allemagne de l'Est.
Ses travaux portent principalement sur la vie et l’œuvre de la philosophe politique Hannah Arendt. Elle est fondatrice et lectrice du Centre Hannah Arendt de l'université d'Oldenburg.
- - - - -
***ASJA LACIS
Anna naît le 19 octobre 1891 à Kemeri Manor, près de Ligatne, petite ville de ce qui était encore la Livonie – sous gouvernement russe, désormais en Lettonie. Sa famille est très pauvre. La mère, Trine Liepina, vend des couvertures, tissées à la maison. C’est une femme pieuse, résignée, acceptant la misère comme un destin. Le père, Ernests Liepins, est journalier, appelé par les paysans du coin pour coudre des fourrures ou réparer des selleries. Ayant déménagé à Riga, il trouve un emploi dans une usine de wagons. Contrairement à son épouse, il est révolté, participe aux luttes ouvrières et paysannes, prend part à la grève massive de 1899 et aux manifestations contre le pouvoir tsariste de 1905. Trine et Ernests divorcent bien vite : Anna est confiée à sa mère, mais son éducation, elle la reçoit de son père, qui l’emmène distribuer des tracts, lui fait lire la Femme et le Socialisme d’August Bebel, et forge «sa vision de la société et du monde, du droit et de l’injustice, de la vie digne ou indigne». C’est son père aussi qui, se saignant aux quatre veines, l’inscrit au lycée –«unique enfant d’ouvriers», sujette aux lazzis et aux humiliations de ses condisciples. C’est là que s’éveille la passion pour la littérature et le théâtre. Devenue une «jeune fille curieuse, avide de lecture, sûre d’elle-même», elle veut faire des études dans la capitale russe – où venait d’être créé l’Institut de psychoneurologie, comportant une faculté de formation général…
Spécialiste reconnue des travaux et de la vie d'Hannah Arendt, Antonia Grunenberg entraîne son lecteur dans une narration philosophique en vue de résoudre une énigme captivante: comment la passion amoureuse vécue par Walter Benjamin avec Asja Lācis, femme de théâtre, metteuse en scène, dramaturge et comédienne, a-t-elle pu faire de l'intellectuel assuré de ses convictions, de l'auteur de Paris, capitale du XIXe siècle, un marxiste convaincu et un admirateur enthousiaste du communisme apparu au berceau de l'Union soviétique?
Le lecteur n'aura pas la clef de l'énigme mais verra s'ouvrir, chemin faisant, de nombreuses portes sur l'œuvre de Benjamin et sur la vie intellectuelle, la culture, le théâtre, à Berlin, Riga, Moscou dans l'entre-deux-guerres. Sur la scène défilent les figures intellectuelles d'Adorno, Horkheimer, Kracauer, Marianne Weber et les inventeurs d'un nouveau théâtre, Brecht, Piscator, Bernhard Reich et bien d'autres.
Le destin tragique des deux protagonistes, le suicide de Benjamin à quelques encablures de l'exil, la souffrance d'Asja Lācis dans les camps de travail de Staline, au lieu de clore les deux biographies dans une version romantique de l'amour contrarié, incite avec une grande sobriété le lecteur à une réflexion interminable: est-il vrai qu'il ne restait plus à Benjamin que «la tête et le sexe», comme l'écrivit son épouse Dora Sophie, désorientée par cette conversion idéologique, à leur ami commun Gershom Scholem? Peut-être Asja avait-elle, à l'encontre de Walter, ses propres convictions «chevillées au corps». Une énergie de la personne toute entière qui la conduisit à rester en Union soviétique jusqu'au bout.
Pour inventorier les dédales de l'énigme, il ne suffit pas en effet d'invoquer le messianisme de Benjamin, de qualifier sa nouvelle orientation idéologique de «conversion», et de reprendre les poncifs éculés sur le caractère religieux de la croyance au communisme.
Pour comprendre le rôle de la passion amoureuse, ne faut-il pas avant tout saisir la rencontre entre Walter et Asja, telle bien d'autres rencontres amoureuses, comme une expérience de structure religieuse? Ne faut-il pas la configuration de ces trois figures: le coup de foudre, l'idéal communiste et l'attente, l'espoir, la vision d'un monde meilleur d'autant plus pressante que l'on pressent, avec Benjamin, la catastrophe et que l'on ressent, avec Asja, la montée de la terreur stalinienne?
Dans son commentaire sur Siegfried Kracauer, l'auteur de Les Employés – Aperçus de l'Allemagne nouvelle, Walter Benjamin avait salué chaleureusement «un chiffonnier à l'aube de la révolution». Dans les méandres de la passion qui unit Walter et Asja, le lecteur perçoit les affinités secrètes et les correspondances qui relient l'amour à l'émancipation.
Walter et Asja – Une histoire de passions
Antonia Grunenberg
Traduit de l'allemand par Olivier Mannoni
Payot
2022
224 pages
18 euros
commenter cet article …


/image%2F1231070%2F20220503%2Fob_463966_asja.jpeg)
/image%2F1231070%2F20220503%2Fob_4b459d_asja-l.jpg)
/image%2F1231070%2F20220503%2Fob_189f64_lacis-anna.jpg)
/image%2F1231070%2F20220503%2Fob_d11e8c_walter-benjaminbookweb-jpg-1600.jpeg)
/image%2F1231070%2F20220503%2Fob_da8196_walter-benjamin1-3-203x250.jpg)


/image%2F1231070%2F20210307%2Fob_20f04a_url.jpg)




/image%2F1231070%2F20210214%2Fob_2b5cd7_llo.JPG)
/image%2F1231070%2F20210214%2Fob_45392c_sorbonne.jpg)




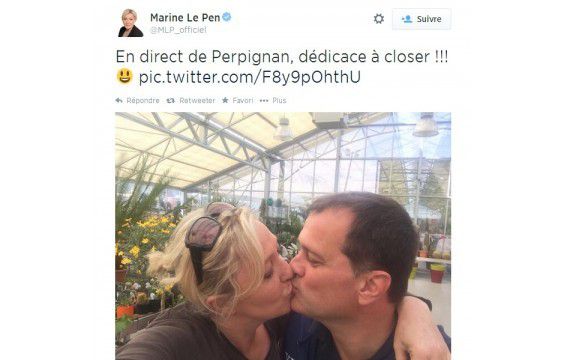
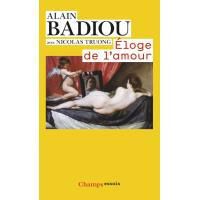



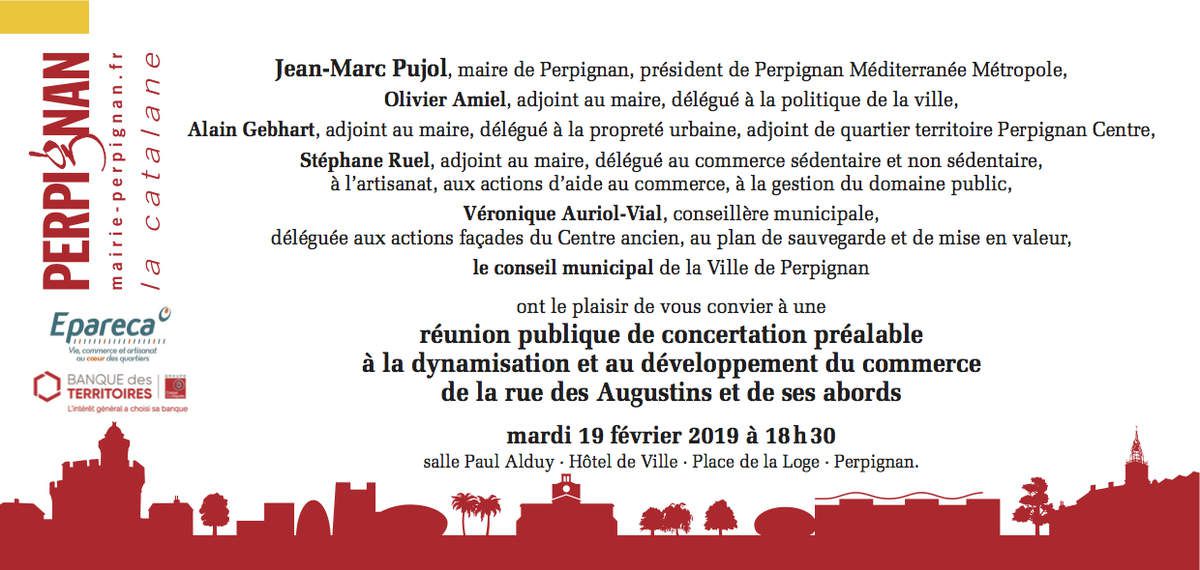

/image%2F1231070%2F20140922%2Fob_752b59_je-veux-aimer.jpg)