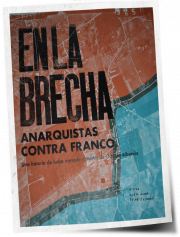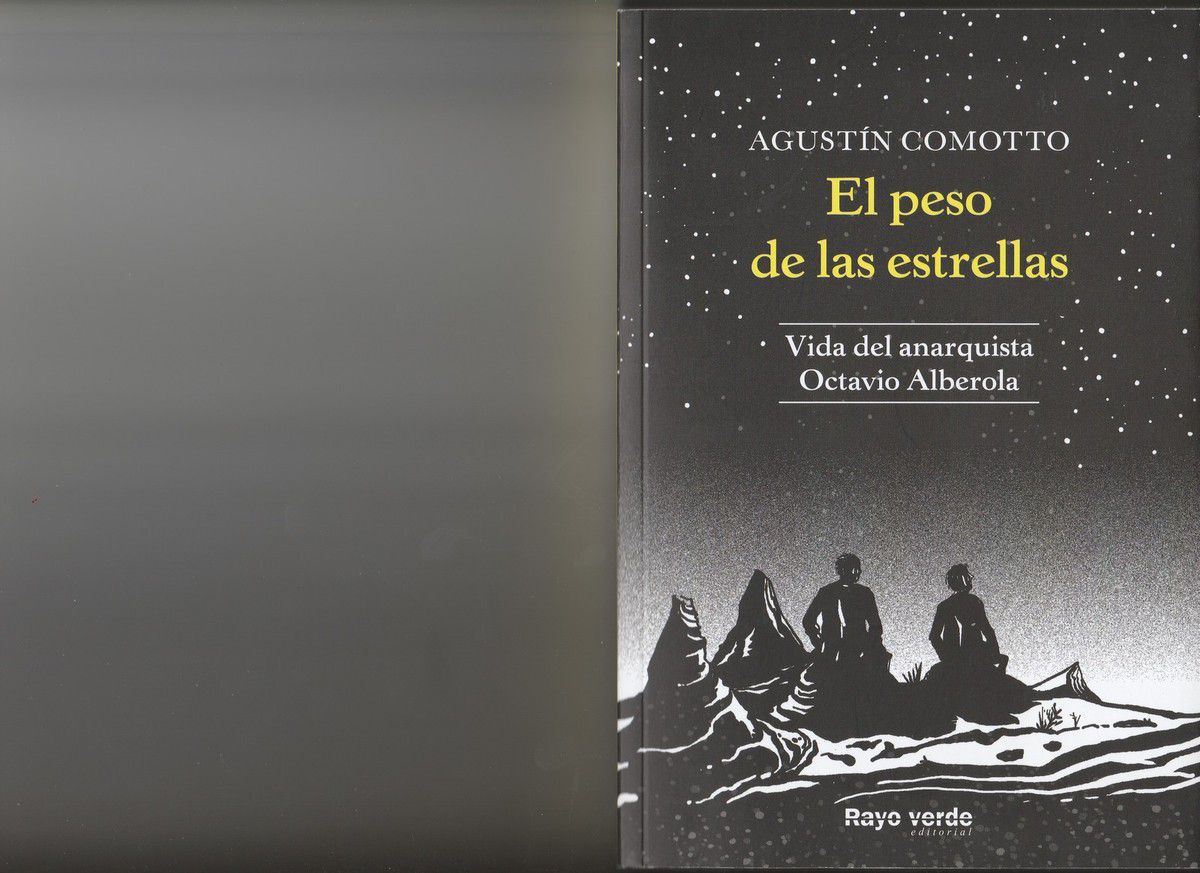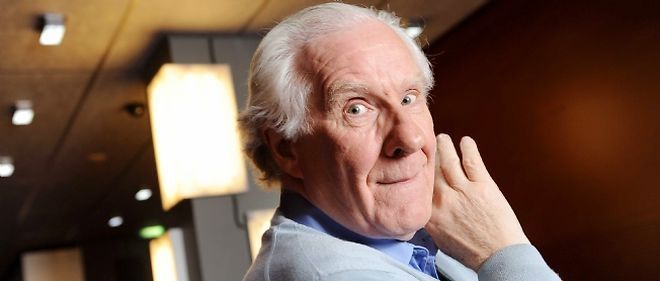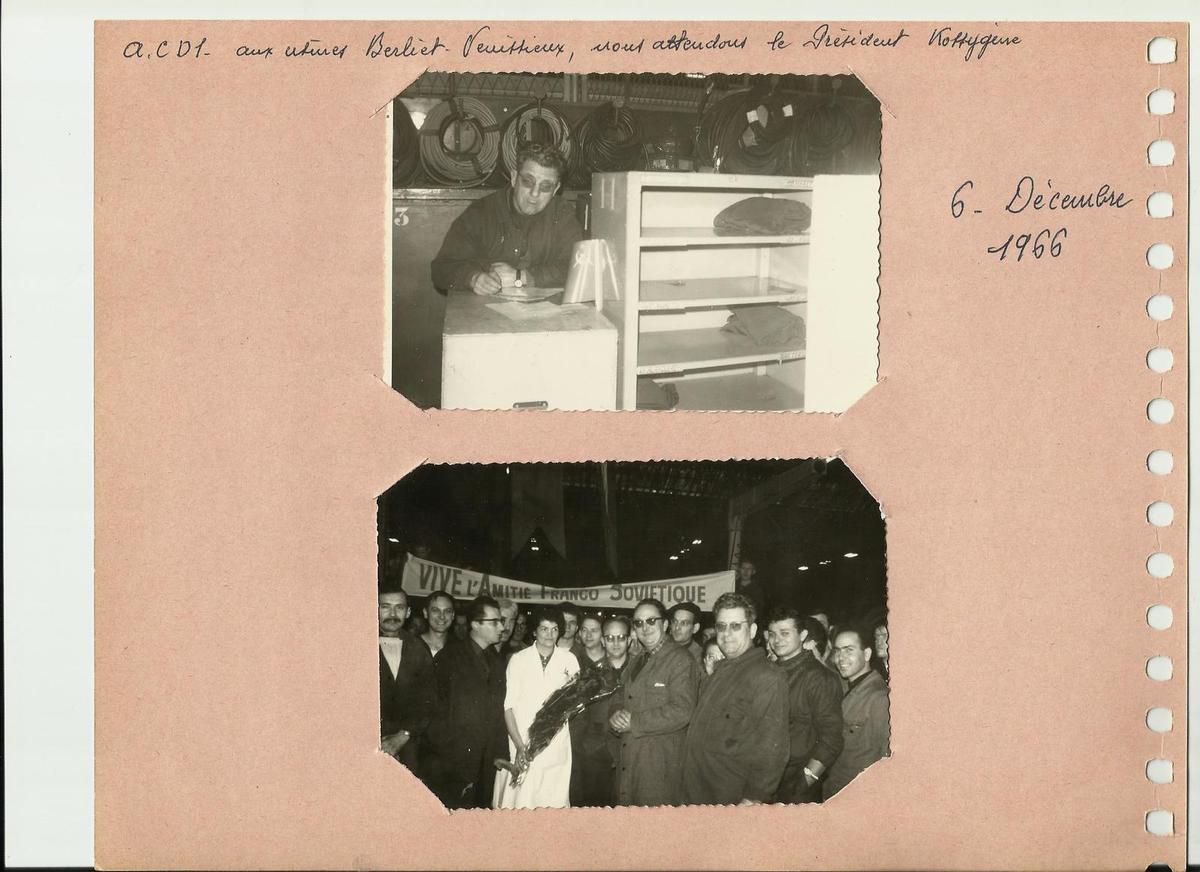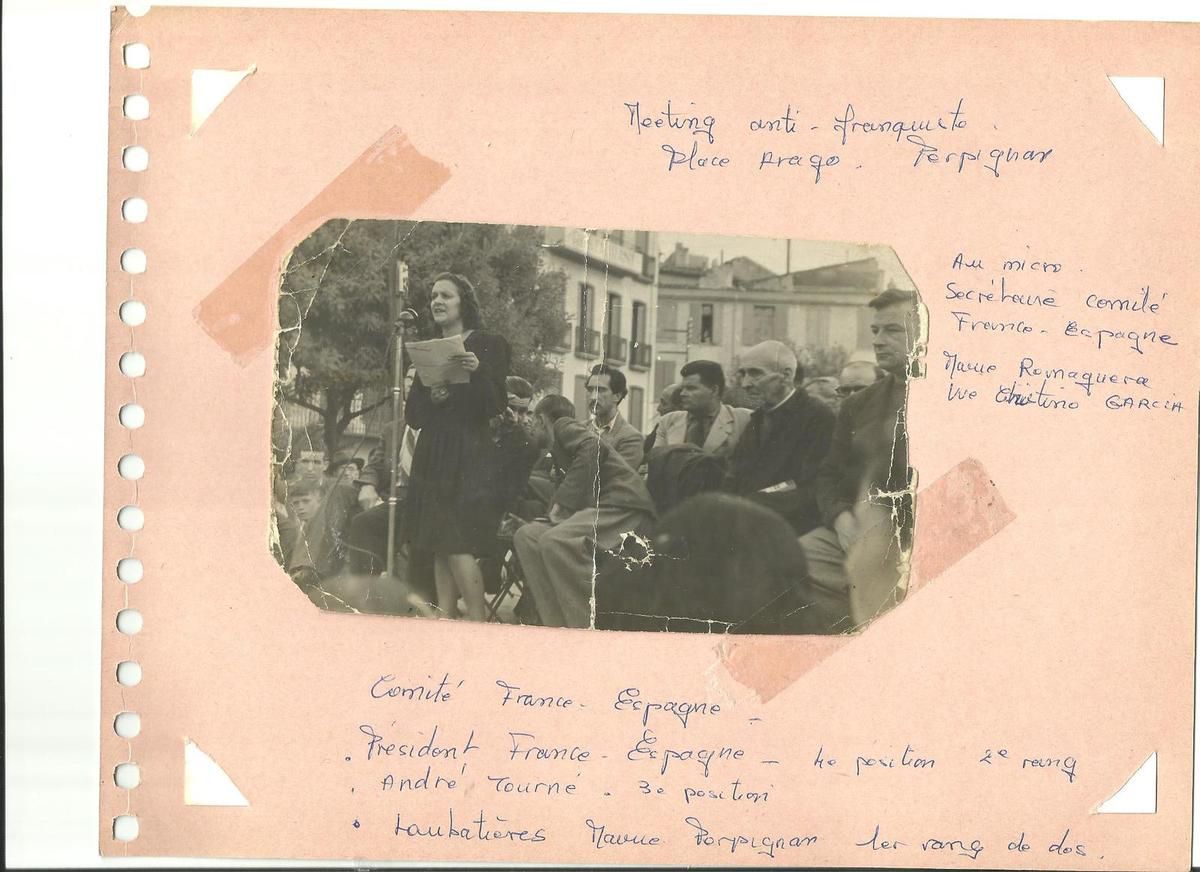Léopold Roque, déporté, militant syndical et responsable communiste (suite)
EYSSES, maison de « redressement » pour délinquants juvéniles, devenait une prison centrale pour 1200 détenus, jugés et condamnés, à peu près tous, dans les mêmes conditions que ceux qui venaient de Tarbes.
Dans cette prison pour adolescents, avait été déjà créé un quartier pour adultes où je retrouvais quelques camarades isolés, au milieu des droits communs, travaillant dans les ateliers de sabots, de caisses etc…
Notre groupe était le premier de ceux qui devaient, par la suite, constituer le Bataillon FFI de la centrale d’Eysses.
C’était le début d’une nouvelle étape de notre combat de prison.
Centrale d’Eysses – Préau 4 -
Léopold Roque assis en bas, à gauche.
Photo prise clandestinement (appareil apporté par l’épouse d’un détenu).
Dès notre arrivée à Eysses, nous avons été traités comme des droits communs : tenue de bure, cheveux coupés, lacets enlevés. Ce fut le motif de notre première protestation dans cette nouvelle prison.
Les arrivées se sont succédé le lendemain et les jours suivants, jusqu’à ce que l’effectif soit au complet.
Nous nous sommes retrouvés 1200, venant à peu près de toutes les prisons de la zone sud, après un tri fait dans chacune de ces prisons.
Et si chacun a revêtu la tenue de bure (1), il n’y a pas eu de cheveux rasés, ni lacets et ceintures enlevés.
Nous étions répartis dans les 4 préaux : avec Arthur Vigne, nous étions nommés pour assumer la responsabilité d’organisation au préau 4. Les responsables désignés par préau, nous constituions le comité du Front National de la prison, où nous nous retrouvions : communistes et gaullistes. L’appareil dirigeant du Comité se trouvait au préau central n° 2 avec Michaut etc. Régulièrement, nous nous réunissions dans une salle aménagée pour les réunions et spectacles.
L’organisation commençait à prendre corps et dès le mois de novembre 1943, à peu près tous les services, infirmerie, cuisine, dépôts d’habillement, hygiène, étaient assurés par des prisonniers politiques, membres du bataillon FFI, à l’exception du quartier cellulaire où Lescorat avait préféré rester avec quelques résistants au milieu d’un effectif largement dominé par les droits communs.
Dès cet instant, pour ceux qui avaient des responsabilités dans les préaux et pour être reconnus des gardiens et faciliter notre déplacement à l’intérieur de la prison, la Direction avait apporté des changements dans notre tenue vestimentaire : veste bleue et pantalon de velours.
Notre emploi du temps était orienté vers la perspective de notre évasion collective : appareil militaire placé sous l’autorité du commandant Bernard Becoude par le capitaine Gelouze, (postier de Narbonne) de l’effectif du préau 4, cours théoriques et pratiques pour les cadres militaires, le matin longue séance de culture physique pour tout l’effectif à l’exception des plus âgés et malades, cours de culture générale, histoire, géographie, mathématiques, français, langues vivantes, sports et loisirs.
Les internés, c’était un groupe de 156 personnes venues du camp de Nexon, qui n’avaient jamais été condamnées, mais arrêtées car communistes, parmi lesquels se trouvaient des anciens des brigades internationales et combien d’autres militants actifs, connus ou moins connus. Internés sans condamnation, ils étaient moins libres que nous, sous prétexte qu’ils n’étaient que de passage pour quelques jours : ils étaient consignés au 1er étage du bâtiment. Le rez-de-chaussée, en face des cuisines, servait de réfectoire à l’effectif des préaux 1 et 4.
Nos prévisions du danger de la déportation s’avérèrent justes. Le 8 décembre, 109 internés sur les 156 étaient dirigés vers le camp de Voves en zone nord, sous contrôle direct des Allemands. Leur transfert échoua grâce à l’astuce et à la résistance des cheminots.
Nos camarades rejoignent la prison, mais notre collectif se mobilisa. Le 10 décembre le bataillon FFI, sans armes, fait face à 200 GMR munis de mitrailleuses et disposant de bombes lacrymogène, qu’ils lancent à l’intérieur de la chambrée des internés et contre notre colonne.
Ils avaient le masque en avant, nous faisions face, protégeant nos yeux, le nez et la bouche avec nos mouchoirs. Les internés réussirent à se joindre à nous, les GMR furent stoppés, les pourparlers furent engagés entre les dirigeants de notre bataillon et le commandant des GMR. La tentative de Vichy de livrer nos camarades aux Allemands échoua. Le lendemain, 11 décembre, ils furent transférés à Sisteron : nous avions gagné ce combat, ils ne furent pas déportés.
Notre vie de prisonniers reprenait son cours : instruction militaire, enseignement général, organisation des loisirs.
Préparation de Noël 1943, rassemblant le contenu des colis reçus, par chacun de nous, avec le collectage effectué à Villeneuve sur Lot, parmi la population, qui vivait intensément dans une atmosphère imprégnée par l’activité de la prison. Nous avons organisé cette soirée de Noël 1943, qui marqua notre passage, par le souvenir qu’elle laissa chez les prisonniers que nous étions. Nous savions que les difficultés d’approvisionnement étaient grandes à l’extérieur, aussi nous avons été surpris de voir du vin sur nos tables de réveillon.
J’ai eu l’occasion, lors de notre congrès de la FNDIRP, en mai 1969, de présenter celui qui nous avait livré le vin à l’intérieur de la prison : c’était l’ancien international de rugby, Daffis, accompagné d’un résistant en liberté. A Villeneuve sur Lot, on connaissait Daffis, comme sportif aux qualités exceptionnelles, mais ce que la population ignorait, c’était le courage et le désintéressement dont il avait fait preuve à l’égard des détenus de la centrale d’Eysses. Avec un autre international, ils exploitaient un commerce de vin dans la ville. Les 600 litres de vin de Noël 1943, étaient le cadeau que reçurent les 1200 membres du bataillon FFI de la centrale d’Eysses. C’était l’économe, dont les témoignages ont toujours été favorables à la cause des membres de notre bataillon, qui facilitait notre contact avec Daffis.
Le jour de l’an 1944 fut également marqué par l’arrivée sur nos tables d’un peu de supplément à l’ordinaire. Il faut ajouter que l’ordinaire de la centrale, en cet hiver 43/44, n’était pas des plus recherchés : graines de Vesce (plante) et oignons cuits à l’eau !
Ces « fêtes » de fin d’année 43 et début 44, le souvenir de notre affrontement avec les GMR, avaient contribué à forger un moral à toute épreuve : c’est dans cette ambiance que se préparait notre évasion collective.
Avec le recul, en essayant d’analyser la situation de l’époque, je crois que nous pouvons dire : « Lescorat a mené à bien sa tentative d’évasion en janvier 44, avec une cinquantaine d’autres détenus du quartier cellulaire, dont quelques résistants, mais surtout des droits communs. Ils ont profité de l’ambiance que nous avions créée à l’intérieur de la prison et de l’influence, que notre collectif avait acquise, sur le personnel de surveillance ».
Lescorat, n’avait jamais pris part à l’organisation du Front National de la prison. Il a agi à l’insu de l’état-major du bataillon FFI de la centrale d’Eysses. Cette évasion, de non-responsables, a eu comme conséquence un redoublement de vigilance de la part de l’occupant et compromis le plan que nous avions élaboré avec l’état-major de la Résistance de la région du Lot et Garonne.
Néanmoins, l’occasion se présenta de mettre à exécution notre projet d’évasion collective, le 19 février 1944. (3)
Cinq semaines après les « Trois Glorieuses d’Eysses », 8, 9, 10 décembre 1943, Vichy veut être informé sur la situation de cette prison centrale, aux 1200 détenus politiques, organisés militairement, constituant un Bataillon FFI. Cette mission fut exécutée par l’Inspecteur Général des prisons à Vichy. Elle a été de courte durée.
Le 19 février 44, vers 15 heures, l’Inspecteur, le Directeur de la prison et 5 ou 6 personnes de leur suite, sont au préau 1, dont les détenus, répondant à un geste amorçant le signal, opèrent un mouvement d’encerclement, s’emparent des visiteurs et les ficellent. L’inspecteur et le milicien resteront attachés et couchés sur le sol pendant une douzaine d’heures, le temps que durera notre combat pour tenter de franchir les grilles de la prison.
Je reçois l’ordre de l’état-major d’essayer, avec mon groupe du préau 4, de franchir le portail à proximité des cuisines. Mais le branle-bas de combat à l’intérieur, avait été perçu ou communiqué à l’extérieur et, bientôt, police et miliciens avaient pris position et braqué, fusils et mitrailleuses sur nous, avant l’arrivée des troupes allemandes, appelées par la milice, qui braquèrent aussi leurs canons.
C’est là que se situe ma rencontre avec Aulagne. Au début du combat, il avait été désigné pour appeler les gardes mobiles à fraterniser avec nous. Les coups de feu des forces au service de l’ennemi, entravèrent notre mouvement d’approche du portail de sortie. Il fallut changer de tactique, La forte voix d’Aulagne s’était un peu éraillée : je fus appelé pour le remplacer en haut des toits, pour continuer à appeler les policiers patriotes à se joindre à nous. Rien. Notre armement était insuffisant pour répondre au feu nourri de l’ennemi : Gabriel Pelouze, fusillé le 23 janvier, et Louis Aulagne, mortellement blessé au combat, redoublent d’efforts. Des camarades espagnols, aguerris dans les combats livrés en Espagne contre les fascistes, font de nouvelles tentatives pour atteindre le portail de sortie.
Une fois de plus, il fallait changer de tactique. Du haut du toit de la prison, je suis rappelé, nouvelle mission. Munis d’une lourde pince-monseigneur, nous sommes envoyés au 1er étage, dans une chambre située au-dessus du commandant du GMR. Nous essayons de rentrer en contact avec le chef des forces de police. Mais aux coups de pince qui nous permettent de lever les lames du parquet, répondent les balles de mitrailleuses pénétrant par les fenêtres. Nous avons renoncé. L’état-major du bataillon était au rez-de-chaussée au chevet du commandant blessé d’une balle au genou.
C’est à partir de ce moment que fut décidé d’entreprendre le dialogue avec l’extérieur. L’Inspecteur et le Directeur étaient toujours ficelés, ils répétaient sans cesse qu’il n’y aurait pas de représailles. Heuri Aujias rentra en communication avec la sous-préfecture de Villeneuve-sur-Lot.
La réédition est décidée le 20 février à 4 heures du matin.
Le 21 février, 56 otages, sommes désignés et amenés au quartier cellulaire. L’appel est fait dans les préaux. Les appelés, par ordre alphabétique rejoignent les réfectoires à tour de rôle. Arrivent les appels des noms en S, lorsque je fais part au 1er surveillant de mon étonnement de ne pas avoir été appelé à la lettre R. Il s’interrompt quelques secondes et me répond : « Mon pauvre Roque ».
Les non-appelés restons dans la cour, un à un, nous sommes dirigés vers le quartier cellulaire. J’étais précisément, derrière le 1er surveillant qui avait fait l’appel, mais en plus, deux miliciens, révolver au poing à mes côtés, et derrière 6 Allemands, baïonnette au canon. Je me suis retrouvé dans la même cellule avec Brun Roger, 20 ans et Lajudie Maurice, 23 ans, les otages que Darnaud, chef sanguinaire envoyé par Vichy, avait demandés. Mais il a été mis en échec grâce au patriotisme dont firent preuve la population dans cette région de France et l’activité des maquis.
Le 23 février 1944, douze blessés au combat furent fusillés, de même qu’Henri Aujias, communiste, désigné comme le principal responsable de la révolte d’Eysses.
Au lever du jour, les portes des cellules s’ouvrirent, des noms appelés : nous étions conscients du sort qui nous était réservé, aussi pour celui ou ceux qui resteraient, nous avions écrit l’adresse de nos familles sur un papier laissé sur la table de la cellule.
Nous étions dans l’attente de cette ouverture de porte, Brun se tenait au fond sous la fenêtre, Lajudie était au milieu de la cellule, appuyé à la table, tandis que je me tenais à la porte prêt à sortir. Je ne sais si c’est par pur hasard, mais c’était toujours ce même premier surveillant qui, apparemment ému, me mit la main sur l’épaule et me dit : « Non pas vous » et il appela le plus jeune, Brun Roger, 20 ans.
Vers 7 h du matin, la Marseillaise puis le Chant du Départ, repris à l’intérieur par les détenus du quartier cellulaire, et enfin, le crépitement des balles résonnent. Lajudie tombe dans mes bras : douze des nôtres sont morts, ils rejoindront Aulagne au cimetière de Villeneuve-sur-Lot. Lajudie mourut un an après en déportation au camp d’Allach à Munich.
La répression n’est pas terminée pour autant. C’est d’abord la brigade politique de Limoges qui entreprend l’enquête, fouille de la prison de fond en comble, interrogatoire pressant. Je me rappelle le faciès des deux policiers devant lesquels je me trouvais : un brun à forte corpulence à la machine à écrire, l’autre svelte au teint plus clair qui me dit : « Et vous, vous ne savez rien non plus » je lui répondis : « Vous l’avez dit, je n’ai rien à signaler», il répliqua en me bousculant : « Et ça » me montrant ma fausse carte d’identité au nom de Robert Laporte né à Bordeaux en 1906. Je pensais pourtant l’avoir bien cachée dans la fente d’une poutre sous le toit. C’est la preuve d’une minutie sauvage et perfide de leur fouille. Cette forme violente d’interrogatoire fut interrompue au bout d’une quinzaine de jours.
A la brigade de Limoges succédaient les policiers de la brigade politique de Toulouse. Ce commissaire de police était un ancien enseignant.
En 1931, je l’avais rencontré à Port-Vendres, où il était instituteur, à l’occasion d’une réunion publique, pendant une élection législative partielle de la circonscription de Céret. Il était membre du parti socialiste, soutenait la candidature de Parayre, tandis que je soutenais la candidature de Terrat, candidat du parti, tous les deux portant la contradiction au candidat de droite.
Ce furent ces souvenirs, sachant que je me trouvais parmi les prisonniers, dont il avait au préalable consulté la liste des 1200, qui le décidèrent à m’appeler dans les premiers, bien avant la lettre R. Il m’annonçait que Darnaud voulait faire un vaste procès où seraient jugés les présumés responsables de la révolte d’Eysses. J’usais de ma qualité de Catalan, comme lui, utilisant notre langue maternelle, pour lui dire ce que les détenus patriotes de la centrale d’Eysses attendaient de lui. Il nous était interdit d’écrire. Dès le début de notre conversation, il me demanda de rédiger une lettre pour ma famille, que je lui remis dès le lendemain, pour l’expédier. Je lui demandais de faire un geste pour le plus grand nombre possible de camarades : je crois qu’il le fit pour la trentaine de Catalans se trouvant à Eysses. Ce fut un peu mieux dans notre situation de prisonniers.
Notre conversation porta sur l’enquête qu’il était chargé de mener et me certifia qu’il la ferait traîner le plus longtemps possible afin de gagner du temps. Notre moyen de défense à tous fut : « Je ne sais rien, je n’ai rien vu, j’étais à la chapelle ».
Effectivement, l’enquête traîna, le procès n’eut pas lieu. A partir du 21 avril 1944, les Allemands m’ont confié qu’eux-mêmes s’occuperaient de nous, en décidant de notre déportation, seul moyen pour eux de s’assurer d’une condamnation collective des membres du bataillon FFI de la centrale d’Eysses.
C’est pourquoi le 18 mai 1944, 36 des détenus furent transférés à la prison de Blois, quittant le quartier cellulaire, où nous ne restions plus qu’une dizaine.
Le 30 mai, douze jours après, nous quittions Eysses pour Compiègne : le 20 juin nous arrivions à Dachau, alors que les alliés avaient débarqué en Normandie. Le 2 juillet, ceux de Blois nous rejoignaient en terre allemande.
Ceux qui nous ont accompagnés, d’Eysses à Compiègne, avaient l’expérience du massacre collectif. C’était ceux de la division Das Reich, qui s’étaient déjà montrés à Oradour-sur-Glane et Tulle. Un de nos camarades, le Républicain Espagnol Huerga, épuisé, fut achevé par balle sur les bords de la route, nous conduisant de Villeneuve sur Lot, en gare de Penne d’Agenais.
L’expérience d’Eysses : organisation, solidarité, furent appliquées partout, dans tous les commandos où se trouvaient des anciens d’Eysses. Cette organisation de la solidarité « une cuillère de soupe », fut admise par la quasi-unanimité des déportés de toute nationalité.
L’organisation, au centre d’Allach, et les rapports entre communistes et gaullistes (fournisseur de main-d’œuvre à l’usine BMW), ont été confiés à Henri Neveu, Conseiller Municipal de Paris.
Au mois de décembre 1944, je suis atteint de conjonctivite : à l’infirmerie d’Allach, on m’avait arraché presque toutes les dents, sans anesthésie. Vers la mi-janvier 1945, les Allemands m’envoient à Dachau et à l’infirmerie, où je retrouve Auguste, le cheminot de Marseille, on me fabrique un dentier. J’étais dans un bloc avec les Tchécoslovaques, j’évitais de me montrer pour échapper aux corvées, cette manœuvre dura jusque vers le 20 mars 1945, où avec une trentaine d’autres déportés, je regagnais Allach.
Dès mon retour, j’appris qu’Henri Neveu était gravement malade : je pris la relève dans les contacts avec les gaullistes et c’est ainsi que je rencontrai M. Rivière et Georges Briquet, chaque dimanche au camp, et en semaine, sur les voies ferrées à Munich. Les matières premières étaient de plus en plus rares, le commando de l’usine BMW s’amenuisait, par contre, ceux occupés à la réfection des voies ferrées augmentaient, sans cesse, journellement, l’aviation alliée faisait des ravages en gare de Munich et ses environs.
Ces bombardements, lorsque nous étions à l’usine, nous obligèrent à courir vers les tranchées dans les bois. Sur la voie de chemin de fer, nous nous répandions dans les fossés sous la surveillance des SS et des chiens policiers. Pendant les bombardements de nuit, nous regagnions les tranchées couvertes du camp. Je m’arrangeais pour rester à l’entrée de la tranchée : avec les SS, nous ne regardions pas la chute des bombes de la même façon ! A ces instants précis, dans la nuit, lorsque ces chapelets de feu atteignaient le sol à grand fracas, le visage pâle des SS apparaissait d’un blanc cadavérique, tandis que chez les prisonniers, c’était le sourire et quelque fois perçait un cri de bravo.
Ce n’est pas pour faire étalage de je ne sais quel courage, c’était intuitif pour nous tous, de demander encore et toujours des bombes pour écraser notre ennemi qui nous faisait vivre un enfer. Car le danger, que faisait peser sur nous les nazis, à chaque instant, à chaque seconde et cela depuis des mois, était bien plus grand que celui de voir tomber les bombes. Ces bombes nous les regardions tomber, les coups que nous portaient les nazis, nous n’avions pas le temps de les voir.
Les troupes alliées approchaient. Les 26, 27 et 28 avril, les SS rassemblaient tous les individus pour les amener hors du camp. Nous avons appris, que c’était pour les massacrer sur les routes. Nous étions une dizaine à échapper à ces véritables rafles, en nous réfugiant vers les blocs en maçonnerie. Les nazis étaient atterrés : ils s’habillaient avec des vêtements civils, camouflant leur fusil sous leur pardessus. Seuls quelques SS, parmi les irréductible, restaient, tandis que dans le ciel au-dessus du camp, passaient des obus dans tous les sens. Pour nous, et c’était là, tout le paradoxe, nous nous sentions, en ces instants, plus en sécurité à l’intérieur du camp.
Lorsque le 30 avril 1945, vers 11 heures du matin, alors que j’étais agrippé aux barbelés intérieur du camp, face au mirador, où 2 heures avant j’avais été témoin de la fuite du SS, j’aperçu sur la route Dachau-Munich à 200 mètres environ, les premiers soldats américains en terre allemande. A cet instant, j’appelai les camarades attablés devant leur gamelle. A dire vrai, nous ne réalisions pas que nous étions enfin redevenus des personnes libres.
Ce fut d’abord un sous-officier américain qui prit le premier contact avec nous, puis un officier. Le comité du camp se réunit, les contacts furent établis avec l’armée française. Le général Leclerc nous envoya un capitaine quelques jours après l’arrivée des Américains. La semaine d’après, c’était un colonel et puis enfin le Général Leclerc, perché sur une estrade que nous avions élevée, s’adressa à nous : « Nous ne retrouverions pas la France comme nous l’avions quittée ». Les Allemands, dit-il, ont ruiné et ont pillé notre pays. Le Général Leclerc ajouta : « Vous ne trouverez rien en France pour vous chausser et vous habiller, je vous conseille d’emporter tout ce que vous pouvez ».
Ce n’était pas l’avis du commandement américain, qui fit brûler un stock impressionnant, aux abords immédiat du camp d’Allach, chaussures et vêtements.
Nous restions environ 3 jours avec, la majorité des Français. Nous décidions, avec l’accord des responsables, que les plus malades seraient évacués les premiers. Il est regrettable, que nombre de responsables n’aient pas respectés la solidarité humaine.
Je quittais le camp d’Allach, le 26 mai 1945, avec les derniers déportés évacués dans les camions de l’armée Leclerc en direction du lac de Constance. Ce jour-là, j’ai eu l’agréable surprise de retrouver l’un des chefs de groupe de l’armée originaire de mon village natal. C’était le premier camp d’extermination qu’il avait sous les yeux. Il savait que j’avais été déporté. Il s’est alors adressé à un groupe pour savoir si, par hasard, j’étais dans ce camp.
Ce fut mon ami Raoul Vignette (2) qui le renseigna et l’amena près de moi. Je revois encore ce garçon, bien plus jeune que moi, qui me fit faire le voyage sur l’avant du camion à ses côtés, à travers toute la Bavière jusqu’au lac de Constance. Démobilisé, devenu fonctionnaire, il mourut peu après.
Je quittai le lac de Constance, avec le premier convoi, en direction de la France et le 29 mai 1945, en wagon couchette à travers la Suisse, jusqu’à Mulhouse.
Le 30 mai, nous avions un premier contrôle, le 31 mai, 2e contrôle à l’Hôtel Lutécia à Paris ; et le 1er juin, je quittais la capitale pour me retrouver le 2 juin 1945 à Perpignan, puis à Elne. Convalescence pendant quelques semaines à l’hôtel des Sorbiers à Mont-Louis, réquisitionné à cet effet.
Après une période de réadaptation, je revins à la Direction Fédérale des Pyrénées Orientales. Puis en 1948, je suis dans le département de la Loire et en 1950 dans le département du Rhône.
- Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’une telle épreuve laisse incontestablement des traces. Traces dans les organes, handicap physique, traumatisme aussi, ressenti plus particulièrement, lorsqu’il s’agit des luttes passées, présentes, ou futures pour la paix et la liberté, contre la guerre.
Contre les crimes de guerre, contre le fascisme et aussi lorsqu’il est question des revendications des anciens combattants et victimes de guerre. C’est pourquoi, les anciens déportés restent toujours des combattants.
Nous percevons le danger après notre expérience, de ce que représente le fascisme et le racisme qui subsistent dans l’esprit de certains individus, groupes, ou partis qui tentent de réintroduire dans les mœurs politiques, en Allemagne, en France et dans le monde, les théories d’Hitler, Franco et Mussolini.
- - -
(1) vêtement grossier, conçu avec un drap rugueux de couleur marron.
(2)
Né le 15 janvier 1920 à Ortaffa (Pyrénées Orientales), Raoul Vignettes milite au sein des Jeunesses communistes. En janvier 1943, il rejoint les FTP et participe à plusieurs actions : distribution de tracts, récupération et transport d’armes, sabotages, recrutement...
Arrêté le 28 juillet 1943, il est incarcéré durant six mois à la maison d’arrêt de Perpignan. Jugé par la section spéciale de la cour d’appel de Montpellier, il est condamné à un an de prison le 31 janvier 1944 et incarcéré à la maison d’arrêt de Montpellier.
Envoyé à la centrale d’Eysses le 8 février 1944, il participe à l’insurrection du 19 février. Le 18 juin 1944, il est déporté à Dachau après avoir passé quelques jours au camp de Royallieu à Compiègne. Transféré au camp d’Allach puis au kommando Dickerhoff, il est libéré par les Alliés le 30 avril 1945 et rentre à Perpignan le 2 juin 1945.
A son retour de déportation il fut tour à tour rédacteur au journal Le Provençal et secrétaire de la fédération du PCF des Pyrénées Orientales. Président de l’ANACR des Pyrénées Orientales, Raoul Vignettes est décédé en septembre 2005.
(3) – Cet épisode appelé : « La Révolte d’Eysses » : un livre a été édité où l’on parle d’une voix de stentor, celle de Léopold Roque, lorsqu’il se trouve sur les toits. Un documentaire a été également réalisé.


/image%2F1231070%2F20220228%2Fob_64bd2c_maxresdefault.jpg)


/image%2F1231070%2F20210329%2Fob_b21cd3_aliot.jpg)
/image%2F1231070%2F20210329%2Fob_c12bd0_108414d7f36918ba4df1884a88e00d36.jpg)
/image%2F1231070%2F20210311%2Fob_4c5e34_aliot-bal-des-e-tudiants-pangermanis.png)
/image%2F1231070%2F20210311%2Fob_0b20b6_image002.png)